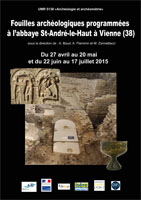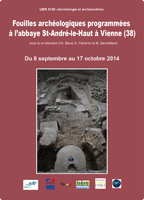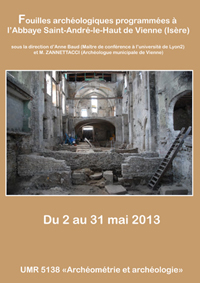Campagne de fouilles et étude du bâti du "vescovado" d’Akerentia en Calabre (Italie)
- du 1er juillet au 29 juillet 2015
Responsable : Aurélie Terrier (Université de Genève - Université Lyon 2, ArAr)
Equipe :
Camille Aquillon (Archéologue)
Damien Colomb (Archéologue)
Céline Girardet (Archéologue chez Museion-epca)
Justine Saadi (Université de Lyon2)
Akerentia fait partie de l’actuelle commune de Cerenzia dans la province de Crotone, qui s’étend sur une superficie de 1700 km2 sur le versant ionique de la péninsule calabraise. La ville est située juste au sud du massif de la Sila et s’élève sur un promontoire à 500 mètres d’altitude. Ce dernier surplombe la vallée du Lese et les collines environnantes.
Selon les sources disponibles, la ville d’Akerentia (ou Cerenzia Vecchia) est habitée sans discontinuité du IXe au XIXe siècle, puis abandonnée en 1860. Elle représente donc un terrain d’investigation très prometteur quant à l’évolution d’une cité entre le Moyen Âge et l’Epoque moderne.
L’étude de cette agglomération entre dans une problématique plus générale portant sur l’incastellamento et de la transformation du territoire entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Il s’agit d’une période charnière de l’histoire de l’Italie méridionale, depuis la reconquête byzantine jusqu’à l’installation du système féodale par les Normands.
Akerentia apparaît à la fin du IXe siècle en suffragant de la nouvelle métropole de Santa Severina au sud du massif de la Sila. De ces nouveaux diocèses constitués, Akerentia est la seule citée pouvant être étudiée sans contraintes, les autres étant toujours occupées. L’abandon de la ville offre donc une opportunité d’étude inédite.
La subite apparition de cette agglomération en tant que cité épiscopale sans l’existence d’une occupation antérieure semble peu probable. La position topographique dominante du promontoire ne peut que conforter ce postulat. De plus, la région est occupée de plusieurs lieux stratégiques (soit en fonction de leur position sur les voies de circulation, soit sur des sites naturellement protégés), par des structures du type enceinte-refuge, et ce à partir du VIe siècle. La mention d’Akerentia ainsi que d’Umbriatico, d’Isola di Capo Risuto et de Gallipoli dans les listes épiscopales de la fin du IXe siècle, démontre bien une volonté de reconquête de l’Empire byzantin de ses anciens territoires. L’un des postulats de cette étude, est, dans la mesure du possible, de déterminer la véritable fonction du dit « vescovado » qui surplombe la ville. À l’heure actuelle, les locaux parlent de cathédrale, mais cela pourrait également être l’emplacement d’un castrum byzantin, d’un château Normand, d’un palais épiscopal ou les quatre successivement et/ou parallèlement.
La prospection radar réalisée en avril par Christian Camerlynck (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 – UMR 7619 Sisyphe) a permit de mettre au jour des structures liées à un bâtiment antérieur. Les opérations de 2015 permettront d’ouvrir deux secteurs de fouilles qui serviront à préciser le plan de l’édifice, aujourd’hui incomplet. Parallèlement à la fouille, l’étude du bâti se poursuivra.