Tome 60 de la Revue archéologique du Centre de la France
Fabrice Couvin, Marielle Delémont et Frédéric Poupon avec la collaboration de Michel Barret, Dominique Canny, Magalie Guérit, Bénédicte Pradat et Christelle de Belvata Balasy
Texte intégral


Amaury Gilles du laboratoire et Stéphane Mauné (dirs.), 2021. Ouvrage collectif, 12 contributions. Ce travail a bénéficié du soutien du LabEx ARCHIMEDE au titre du programme « Investir L’Avenir ». Ce volume rassemble une douzaine de contributions qui traitent de la délicate question de la datation des contextes des IIe et IIIe s. en Gaule narbonnaise. L’aire géographique considérée s’étend de Lyon jusqu’à Fréjus et Béziers. Le parti pris a été de concentrer la réflexion sur les deux principaux fossiles directeurs céramiques utilisés par les archéologues.
Ainsi, l’objectif principal est de préciser dans quelle mesure et à quels rythmes les productions à revêtement argileux non grésé auxquelles est rattachée la sigillée claire B rhodanienne, avaient concurrencé/remplacé les productions de sigillées grésées du Sud et du Centre de la Gaule. Deux articles apportent par ailleurs l’éclairage bienvenu de la vaisselle en verre ainsi que des amphores à huile Dr. 20 dont on connaît la richesse épigraphique.

La céramique à paroi fine
Par Julie Leone, chercheure associée au laboratoire. Collection de l'École française de Rome.
La céramique à paroi fine fait partie des groupes céramiques les mieux représentés dans les contextes archéologiques d’époque romaine, plus particulièrement dans ceux compris entre le IIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C.. Caractéristique de la romanisation, on la retrouve dans l’ensemble de la Péninsule italique et des territoires conquis. Sans pouvoir être regroupée sous une définition technique univoque, elle désigne principalement des vases à boire dont le répertoire morphologique se met en place dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C.Sur la base de découvertes particulièrement abondantes, son émergence a été localisée en Étrurie méridionale...
En savoir plus

Parution du catalogue de l'exposition "L'art et la matière", 2021, avec les textes d'Émilie Alonso, directrice du musée de St Romain en Gal, Cécile Batigne, Armand Desbat et Christophe Caillaud, membres du laboratoire.
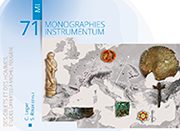
Études offertes à Michel Feugère. Monographies Instrumentum, 71, 2021, aux éditions Mergoil.
Ces mélanges rassemblent en deux volumes 55 articles qui, au travers de plus de 900 pages, explorent la richesse et la diversité de ce que l’on nomme les mobiliers instrumentum. A partir de données inédites, ce sont des études d’objets, de types d’objets ou de corpus de sites qui sont ici éditéss. Ils couvrent un large territoire et une fourchette chronologique allant de la Protohistoire au Moyen Âge, à l’image des travaux de recherche de Michel Feugère, qui a parcouru l’Europe pour étudier les témoins matériels indispensables à la reconstitution de notre histoire.
Ce sont aujourd’hui les objets qui viennent à lui, par ces articles et par la centaine d’auteurs, collègues et amis, qui ont contribué à ces volumes. Ainsi, sans frontières géographiques ni chronologiques, avec pour seul fil conducteur le mobilier archéologique, cet ouvrage propose un condensé de fragments d’humanité.

Une agglomération antique en vallée alpine
Sous la direction de Franck Gabayet et Agnès Vérot - ALPARA - Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Avec la participation de chercheurs du laboratoire.
- IVe de couverture (.pdf)
L’ouvrage rassemble des données issues, pour l’essentiel, de trois opérations d’archéologie préventive localisées aux extrémités orientale et occidentale du bourg. Les sites des Avullions, en amont, et de la Grande Charrière, en aval, offrent désormais un tableau renouvelé de l’évolution de l’agglomération de Thyez durant la période romaine. L’analyse géoarchéologique permet, en outre, de disposer aujourd’hui d’une première représentation de l’occupation du territoire durant l’Antiquité et d’une problématique renouvelée de l’histoire alluviale du secteur avant, pendant et après la colonisation des berges.


Sous la direction de Daniel Istria (dir.), avec parmi les auteurs, Anne Flammin, ingénieur de recherche en archéologie, membre du laboratoire.
Collection de l'École française de Rome
Cet ouvrage collectif est le résultat d’un programme de recherche de quatre années consacré au siège épiscopal de Mariana (Lucciana, Haute-Corse). Après une présentation de la colonie romaine fondée au début du Ier siècle avant notre ère, sont exposés les résultats de l’étude archéologique de cinq édifices de culte chrétien (la basilique paléochrétienne intra-muros et son baptistère, la basilique suburbaine, la cathédrale romane ainsi que l’église San Parteo), des résidences épiscopales successives ainsi que du territoire de cet ancien évêché.
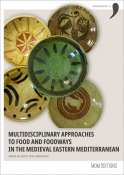

Le troisième numéro de la revue Frontière·s est en ligne en accès libre.
Sous la direction de Cécile Moulin, chercheure associée au laboratoire et Mathilde Duriez, doctorante au laboratoire.