Actualité de la recherche
Référence AHR-38. Sous la direction de François Bérard et Matthieu Poux, 2018, 372 p. coul, 200p. illus. (ISBN : 978-2-35518-064-4), avec le soutien de l'Association Guillaume Budé.
sommaire et résumé


Parution des résultats de la thèse de Quentin Sueur réalisée en cotutelle entre les universités Lyon II et Tübingen sur le thème de la vaisselle métallique comme marqueur de Romanisation en Gaule Belgique.
Monographie Instrumentum ; 55, 637 p., Collection dirigée par M. Feugère
plus d'info

Michel Feugère, chercheur au laboratoire ArAr.
2018, 87 p., coul, (ISBN : 978-2-35518-055-2)
Cet ouvrage se présente comme une introduction à l’étude des objets, catégorie très diverse et touchant à pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne. La discipline s’étant constituée après les autres spécialités traitant des vestiges anciens (numismatique, céramologie...), elle ne peut être mieux définie que par soustraction : les objets, c’est ce qui reste du mobilier archéologique quand on en a retiré la vaisselle d’argile et les monnaies.
Malgré les efforts des spécialistes, notamment les archéologues dont le statut dépend de l’existence d’une spécialité, cette approche scientifique n’a pas encore de nom : parlera-t-on bientôt d’artefactologie ?
- lien éditeur

Au Japon et en Europe
Sous la direction de Masatsugu Nishida, Nicolas Reveyron et Jean-Sébastien Cluzel.
- couverture (.pdf)
La collaboration internationale qui réunit depuis plusieurs années des chercheurs du Kyoto Institut of Technology, de Paris IV-Sorbonne et de notre laboratoire ARAR s'est intéressée à l'approche comparatiste et pluriculturelle de l'architecture médiévale. Ce travail débouche aujourd'hui sur la publication du colloque international de Kyoto (novembre 2014) : "L’idée d’architecture médiévale au Japon et en Europe" aux Editions Mardaga. La perception croisée de l'architecture médiévale par des chercheurs d'une autre culture fait apparaître des questionnements nouveaux sur un sujet réputé déjà bien balisé.
Parution de l'ouvrage "Medieval MasterChef, Archaeological and Historical Perspectives on Eastern Cuisine and Western Foodways" par J. Vroom, Y. Waksman & R. Van Oosten (Eds.), Medieval and Post-Medieval Archaeology Series II, Brepols (Turnhout), 2017.
plus d'information sur POMEDOR
Parution de l'ouvrage "Faïences et majoliques du XVe au XVIIe siècle en France et en Belgique, Pour un bilan des connaissances archéologiques" sous la dir. de Fabienne Ravoire et Alban Horry, Ed. Universitaires de Dijon, Collection : Arts, Archéologie et Patrimoine, 2016.

Parution de la thèse de Morgane Andrieu - Graffites en Gaule Lyonnaise. Contribution à l'étude des inscriptions gravées sur vaisselle céramique. Corpus d'Autun, Chartres et Sens. - Préface G. Sauron, Monographies Instrumentum /54, Ed. Mergoil, Coll. dirigée par M. Feugère, 2017, 454 p.
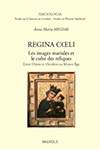
Parution de la thèse d'Ana Migdal, soutenue au sein notre laboratoire ARAR, sous la direction de N. Reveyron - Regina Cœli. Les images mariales et le culte des reliques, Entre Orient et Occident au Moyen Âge, Brepols Publishers, 438 p., 2017.
Ana Migdal vient de publier chez Brepols la thèse qu’elle a faite et soutenue au sein notre UMR ARAR, sous la direction de N. Reveyron. Cet ouvrage sur l’image médiévale intitulé : Regina Cœli. Les images mariales et le culte des reliques et sous-titré : Entre Orient et Occident au Moyen Âge, illustre bien la diversité des travaux sur l’image menés au sein de l’équipe 3 d’ARAR, entre histoire de l’art, anthropologie, organisation de l’espace ecclésial et modes de dévotion.
Extrait de l’annonce : « Les images-reliquaires, dont la singularité attire notre attention, se définissent par la complexité de leur composition tant au point de vue artistique qu’au point de vue religieux. Il s’agit ici des peintures sur panneau de bois (plus rarement, sur verre églomisé), ayant fonction de porte-reliques, et décorées dans certains cas de pierres précieuses ou semi-précieuses. Le modèle de tableau-reliquaire : panneau unique, diptyque et triptyque comprenant le portrait de la Vierge à l’Enfant enchâssé dans une large bordure incrustée de reliques, se répandit particulièrement dans la péninsule italienne, et par la suite en Europe centrale. Cependant, les reliquaires polonais, connus sur le territoire de la Petite-Pologne durant le XVe siècle jusqu’au début du siècle suivant, ne sont mentionnés que de manière sporadique dans l’histoire de l’art. Ils sont apparus dans quelques articles, mais sans avoir fait l’objet d’aucune analyse spécifique quant à leur contenu iconographique, leur similarité formelle, ainsi qu’à l’égard de leur usage dévotionnel. C’est pourquoi, nous souhaitons les joindre aux créations semblables répandues dans l’art entre Orient et Occident au Moyen Âge. Dans la même optique, il serait également intéressant de s’interroger sur la continuité de tels objets au-delà de l’époque médiévale ».
Parution de l'ouvrage "L’église, lieu de performances, In Locis competentibus", ss dir. St.-D. Daussy, avec la coll. de N. Reveyron, éd. Picard, 2016.
- Sommaire (.pdf)
- Présentation de l'ouvrage le 21 mars 2017 à 17h30 à l'INHA salle Vivienne aux côtés de N. Reveyron, J-P. Deremble (Lille3) et G. Grandgeorge (Picard).

Histoire de l'occupation du Quartier Nord-Est du XIIe au XIVe siècle, Fouilles d'Apamée de Syrie 3
Académie Royale de Belgique, Bruxelles 2016
Valentina Vezzoli, chercheur associé au laboratoire
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Page suivante
- Dernière page