Étudier et restaurer le bâti médiéval (1850-1950)
Acteurs, méthodes et enjeux
Colloque international organisé par Laura Foulquier, Anelise Nicolier, Olivia Puel et Haude Morvan, Université de Bordeaux, Ausonius
Du 3 au 5 juin 2021 - en webinaire
- programme (.pdf)
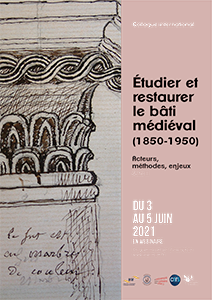
L’histoire de l’architecture médiévale fut écrite, à partir du milieu du XIXe siècle, par des hommes dont la formation, le parcours professionnel et les objectifs étaient variés. De fait, ils élaborèrent chacun leurs méthodes d’analyse et leurs grilles de lecture du bâti médiéval, lesquelles sont à l’origine de nos pratiques en histoire de l’art et en archéologie.
S’intéresser à ces hommes et à leurs travaux : tel est l’objet de ce colloque qui permettra de mettre en œuvre, à l’échelle de l’Europe occidentale, une approche épistémologique des sciences médiévales consacrées au bâti castral, civil ou religieux.
Actuellement, le thème du regard porté sur l’architecture médiévale au XIXe siècle fédère plusieurs laboratoires de recherche européens. Notre colloque s’inscrit dans cette dynamique et en élargit les perspectives. Il se démarque en effet des grandes tendances de l’historiographie, qui privilégient des hommes et des sites d’exception, en s’intéressant à tous les bâtiments du Moyen Âge médiéval, aussi modestes soient-ils. Cette approche, qui tend à s’affranchir du cas exceptionnel pour s’intéresser davantage au quotidien d’hommes ancrés dans leur territoire, est plus révélatrice de la société elle-même. Le fonds documentaire rassemblé par les érudits du XIXe siècle sur l’architecture médiévale est d’une richesse immense mais elle a été souvent négligée par les historiens, les archéologues ou les historiens de l’art.
L’objectif du colloque est double : il s’agit d’abord de s’interroger sur la conception du patrimoine médiéval qu’avaient nos prédécesseurs pout tenter de comprendre leurs motivations et les enjeux de leurs travaux ; il s’agit ensuite de reconsidérer leurs apports à la connaissance de l’architecture médiévale grâce à l’examen critique des méthodes et des résultats. Au-delà des monuments eux-mêmes, qui tiendront lieu de source majeure, les correspondances de savants, les archives de sociétés savantes, les photographies ou les relevés anciens, ou encore les fonds des Monuments historiques, seront convoqués pour aborder un ou plusieurs des axes suggérés dans l’appel à communication : acteurs du patrimoine, documentation érudite, milieux savants et milieux officiels.